XXe-XXIe siècles
-
Prométhée, c’est le symbole de l’intelligence humaine, de la création, de l’art et de la science; c’est aussi le savant torturé par la recherche, le philosophe par la vérité, le révolté contre toute autorité, le premier champion de la liberté métaphysique. Eschyle, Boccace, Calderon, Goethe, Schelley, Bourges entre autres furent fascinés par le voleur de feu. L’ouvrage de Raymond Trousson déploie l’éventail des interprétations dont le héros de la mythologie grecque a fait l’objet en même temps qu’il décrit son évolution chronologique à travers la littérature occidentale. C’est l’odyssée séculaire d’un des symboles inhérents à notre conscience que nous voyons se dérouler au fil des pages.
-
-

Bête noire des critiques et des bibliographes, les supercheries occupent une place obscure, et parfois honteuse, dans l’histoire de la littérature française. Si l’usage du pseudonyme est un subterfuge banal, il est plus rare – et plus grave, aux yeux des censeurs sourcilleux – qu’un homme ou une femme de lettres attribue ses propres écrits à un être imaginaire. En occultant provisoirement sa responsabilité personnelle, en laissant croire à la réelle existence d’un personnage de pure invention et à l’authenticité de ses œuvres, le simulateur se rend coupable de supposition d’auteur. Sont ici réunis une trentaine d’auteurs effectivement supposés par des écrivains célèbres (Sainte-Beuve, Mérimée, Louÿs, Gide, Larbaud, Apollinaire, Vian, Queneau, Gary…) ou de moindre renommée (Desforges-Maillard, Fabre d’Olivet, Vicaire, Picard, Gandon…). Le corps de l’ouvrage comprend une partie strictement anthologique où figurent, d’un côté, les textes de présentation (généralement biographiques) relatifs aux auteurs supposés, de l’autre, plusieurs " morceaux choisis " de leur production. Des notices spécifiques précisent en outre comment furent conçues, puis reçues, " la vie et l’œuvre " de chacun.
En fin de volume, une étude de synthèse examine l’ensemble des techniques utilisées dans ce genre de supercherie : une typologie des auteurs imaginaires et des auteurs pseudonymes permet de cerner en particulier les différences entre texte apocryphe, plagiat, pastiche et mystification proprement dite. L’analyse de ces stratégies falsificatrices s’appuie régulièrement – au besoin pour les critiquer – sur les travaux de Barbier, Quérard, Nodier, Lacroix, Lalanne, Augustin-Thierry et Wirtz, tous experts en ces délicates et brûlantes questions de littérature légale.
Jean-François Jeandillou, Professeur à l’Université Paris X-Nanterre, est membre de l’Institut universitaire de France. Il a notamment publié un essai sur l’Esthétique de la mystification (éd. de Minuit, 1994) et l’Analyse textuelle (Armand Colin, 1997).
-
-
-
-
-
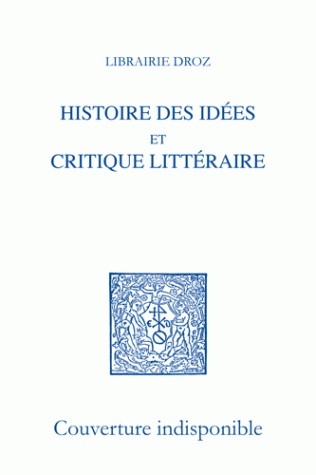
Par un étrange renversement, c'est avec des textes que nous ne lisons presque plus que Chateaubriand s'est acquis auprès de ses contemporains la gloire sans pareille qui fut la sienne, alors que les Mémoires d'outre-tombe, mal acceuillis à leur publication en 1848, sont aujourd'hui unanimement considérés comme un ouvrage unique et une référence essentielle pour notre modernité, non seulement dans sa réflexion sur l'Histoire, mais aussi dans sa mise en œuvre d'une poétique d'une grande complexité et complètement originale.
Table des matières: Marc FUMAROLI, Histoire et mémoire.; Damien ZANONE, Les mémoires et la tentation du roman: L'exception épique des mémoires d'Outre-Tombe. ; Pierre RIBERETTE, Mémoires par lettres.; Béatrice DIDIER, Voyages croisés.; Pierre GLAUDES, Une idée fixe qui vient du ciel: le sublime dans les Mémoires d'Outre-Tombe.; Jean-Claude BONNET, Les formes de célébration.; Hans Peter LUND, Les artistes dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Francesco ORLANDO, Temps de l'histoire, espace des images.; Michael SHERINGHAM, La mémoire-palimpseste dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Agnès VERLET, Epitaphes vagabondes.; Philippe BERTHIER, Mémoire pour rire.; Ivanna ROSSI, La rhétorique allusive.; Jean-Marie ROULIN, La Clausule dans les mémoires d'Outre-Tombe.; Fabienne BERCEGOL, Poétique de l'anecdote.; Antoine COMPAGNON, Poétique de la citation.; Jean-François PERRIN, Figures de lecture; Bernard DEGOUT, Le journal du "Sacre"; Jean-Paul CLEMENT, La Fascination du politique; Jacques LECARME, Ministres autobiographes; Jean Claude BERCHET, Chateaubriand et le théâtre du monde.; Index
-
Yves ANSEL,
Philippe BERTHIER,
Béatrice DIDIER,
Marie-Rose GUINARD CORREDOR,
Ann JEFFERSON,
Catherine MARIETTE,
Sarga MOUSSA,
Marine REID,
Pierre-Louis REY,
Daniel SANGSUE,
Jean SAROCCHI,
Serge SÉRODES,
Christopher W. THOMPSON
On a pu affirmer que le livre De L'Amour est le plus important des ouvrages de Stendhal. "La plupart des idées de Stendhal s'y retrouvent, de sorte que l'on pourrait prendre, dans ce livre unique, une notion fort exacte de l'auteur". Il était temps de consacrer à cette œuvre trop négligée une étude sérieuse. Le présent ouvrage rassemble les actes d'un colloque organisé par l'Institut de Littérature française de la Sorbonne Nouvelle (Paris III) et le Centre d'études stendhaliennes et romantiques de l'Université Stendhal (Grenoble III), à l'initiative des Professeurs Philippe Berthier et Daniel Sangsue. Articles de Yves Ansel, Serge Serodes, Pierre-Louis Rey, Christopher W. Thompson, Marie-Rose Guinard Corredor, Catherine Mariette, Marine Reid, Philippe Berthier, Ann Jefferson, Béatrice Didier, Sarga Moussa, Jean Sarocchi, Daniel Sangsue.
-
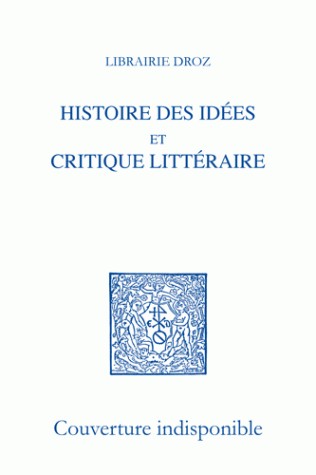
" Interminablement l’enfance " disait Duras, reprenant cette phrase à Stendhal. L’enfance n’a jamais cessé d’être présente dans l’univers durassien : les figures d’enfant côtoient, et parfois croisent, l’enfance indochinoise. L’enfance est un centre signifiant de l’œuvre entière, autour duquel se construisent des réseaux d’images et des figures qui structurent en profondeur l’imaginaire durassien. S’il est vrai que l’écriture de l’enfance n’échappe pas toujours chez Duras à la séduction de la représentation, jouant sur l’exotisme, le sentimentalisme ou la reprise, parfois subvertie, d’une imagerie mythique, on ne peut cependant se limiter à une approche strictement thématique. L’objet de cette étude est également de montrer comment l’exploitation de l’enfance est le lieu d’enjeux d’écriture complexes, significatifs de l’esthétique durassienne dans son ensemble, et plus largement de la production littéraire comtemporaine, touchant en particulier les questions du personnage romanesque, des frontières (roman, autobiographie, prose et poésie), et de la création poétique au sens large.